
Thomas More est bien un homme de notre temps. Ou peut-être, pourrait-on dire qu’il a rencontré une situation qui est hors du temps car elle s’est toujours présentée à toutes les époques de l’histoire. Celui qui exerce le pouvoir l’exerce avec une conception totalitaire qui n’admet pas la contradiction quand ses intérêts sont en jeu.
Ainsi d’Henry VIII, roi d’Angleterre qui avait fait de Thomas More le chancelier du Royaume.
Henry VIII voulant divorcer de Catherine d’Aragon pour épouser Ann Boleyn était également animé du désir de réformer l’Église d’Angleterre. Paradoxe de ce roi qui avait reçu du pape Léon X le titre de « Defensor fidei » pour sa défense des sept sacrements dont celui du mariage.
Thomas More n’a jamais accepté de transiger avec sa conscience. Ce qui l’a conduit à refuser de se soumettre au Roi Henry VIII qui imposait à ses sujets de prêter serment par lequel ils approuvaient l’acte de succession (Succesion to the Crown Act 1533) qui établissait Élisabeth, fille qu’en Henry VIII eut avec Ann Boleyn, héritière légitime et qui règnera sous le nom d’Élisabeth I°. En vertu de quoi il se rendait coupable d’une trahison (Treasons Act 1534).
« Le 31 octobre 2000, saint Thomas More a été déclaré « patron céleste des responsables de gouvernement et des hommes politiques ». Le motu proprio de Jean-Paul II met en avant son « témoignage de la primauté de la vérité sur le pouvoir », son « exemple permanent de cohérence morale » et d’une « politique qui se donne comme fin suprême le service de la personne humaine ». Il constate aussi que la demande de la proclamation émane de personnalités « de diverses provenances politiques, culturelles et religieuses » et que « même en dehors de l’Église, […] sa figure est reconnue comme source d’inspiration ». C’est un fait dont témoignent parmi d’autres, Robert Bolt, le dramaturge anglais agnostique qui écrivit A man for all seasons en 1960, et Fred Zinnemann, le cinéaste juif qui en fit l’adaptation cinématographique avec le succès que l’on sait. Thomas More ne peut être confisqué par sa confession religieuse. Il appartient à tous et parle à beaucoup. Il n’en demeure pas moins qu’il renvoie à un autre que lui, et que son attitude face au pouvoir n’est pleinement intelligible qu’en référence à sa foi. Les conditions extrêmes dans lesquelles Thomas More a été placé peu à peu, ont requis et révélé en lui, ce qu’il convient d’appeler sa sainteté. Sans elle, il n’aurait pas achevé ainsi sa trajectoire politique, dans sa liberté et sa pleine dignité d’homme. » (Conclusion de l’article de Bernard Minvielle, Pouvoir et société. Modèles et figures. in Parole et Silence Centre Histoire et Théologie 2008)

Thomas More est aussi bien connu comme l’auteur de l’Utopie, fiction satirique de l’Angleterre dénonçant les excès qu’a engendrés le mouvement des enclosures qui est parfois considéré comme l’une des origines du capitalisme moderne.
Ainsi peut-on expliquer que son nom figure sur l’Obélisque des Romanov. Cet obélisque fut érigé en 1914 pour commémorer le tricentenaire de la dynastie des Romanov. A l’origine, il est décoré de bas-relief représentant saint Georges, les armoiries des provinces russes et il est couronné par l’aigle bicéphale impérial. On peut y lire les noms des tsars de Michel I° à Nicolas II.
L’obélisque subsiste toujours depuis la Révolution d’Octobre, malgré l’intention initiale du nouveau régime de détruire les monuments à la gloire des anciens monarques. En 1918 l’obélisque subit une transformation pour le rendre compatible avec l’idéologie dominante. Ainsi Thomas More, trouve-t-il sa place en bonne compagnie. De haut on peut lire les noms de Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Liebknecht… Charles Fourier, Jean Jaurès, Proudhon, Bakounine… Tous ces noms ont été approuvés par Lénine.
Cet obélisque se trouve dans le jardin Alexandre (Александровский сад), un parc public de Moscou situé le long du mur ouest du Kremlin. En 2013 l’original restauré a remplacé la copie non conforme.


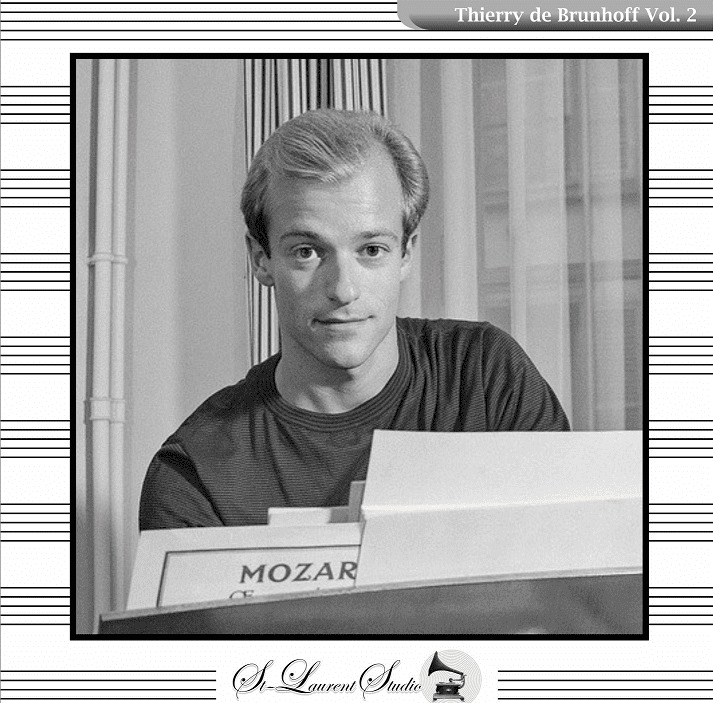


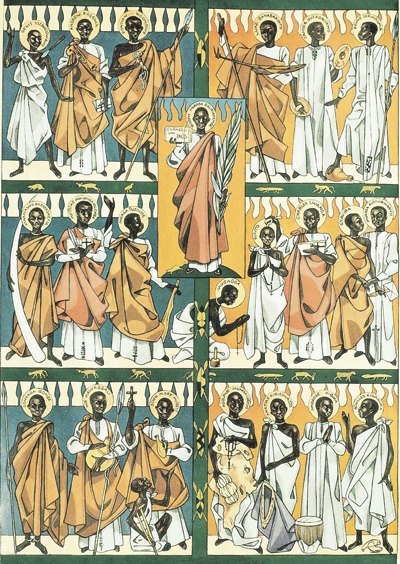















Commentaires récents