« Quand je serai mort, ne viens pas sur ma tombe pour me dire combien tu m’aimes et combien je te manque, parce que ce sont des mots que je veux entendre maintenant que je suis vivant. »
En fin de vie toute situation est et sera toujours personnelle. Au mieux, ce qu’une législation pourrait apporter c’est une nouvelle définition de la mort qu’on appellera « le droit à mourir » ce qui est déjà une fausse piste, la mort n’étant ni un droit ni même une condition mais l’inéluctable terme de notre existence.
Certains voudraient ajouter, pour la rendre plus acceptable, « le droit à mourir dans la dignité ».
La seule raison qui autoriserait à partager le concept est que toute fin de vie doit pouvoir se conclure dans la dignité.
La différence radicale dresse cependant un mur infranchissable : la mort ne peut pas être la conséquence d’un geste positif qui donne la mort mais l’évolution naturelle de toute vie en passant par la fin de vie.
Ainsi, si « l’aide à mourir » venait à être inscrite dans l’article L 110-5 du Code de la Santé comme un « droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance », cet article ne valide pas le droit de donner la mort mais au contraire impose de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour accompagner la fin de vie et ces moyens existent : les soins palliatifs.
Une première conclusion : l’offre des soins palliatifs en France est nettement insuffisante. « Les considérations économiques et financières sont insuffisamment prises en compte dans le débat sur la légalisation d’une aide active à mourir. » Ainsi s’expriment le Docteur Alexis Burnod, Yves-Marie Doublet et le Professeur Louis Puybasset dans une tribune du Monde[1].
On pourra à ce stade de la réflexion dresser la liste de toutes les situations où la fin de la vie s’est présentée avec son cortège de douleurs, de souffrances… Le médecin ne se laissera pas tromper par ce catalogue des situations où la fin de vie aura été un traumatisme de plus au terme d’un combat inégal contre la maladie, contre les circonstances imprévues, aggravées par les maladresses, l’impuissance mais aussi parfois l’incompétence de ceux qui devraient accompagner la fin de la vie.
Tous les professionnels de santé – médecins, infirmières, psychologues, tous les spécialistes exerçant dans les centres de soins palliatifs – engagés auprès des patients pour lesquels une proposition de soins palliatifs a été présentée et expliquée, y compris la perspective du décès, sont unanimes pour dire qu’aujourd’hui un patient en fin de vie peut bénéficier de tous les soins qui lui sont dus et que, dans le cadre de la législation actuelle, loi Claeys-Léonetti[2], il est possible d’assurer une fin de vie digne, aux conditions reconnues de la dignité de toute personne humaine[3].
Une remarque s’impose. Les personnes vraiment habilitées à s’exprimer sur la réalité de la fin de vie sont ces personnes qui vivent au quotidien au contact des personnes en fin de vie et quelles que soient leurs conditions. Je poserais la question à tous les promoteurs du « mourir dans la dignité[4] » : combien de fois avez-vous accompagné une personne en fin de vie ? Il est un peu facile d’exprimer sur le papier ou dans des déclarations ou des manifestes son empathie envers les personnes en fin de vie et de noircir le tableau en parlant des douleurs et de la souffrance insupportables. Tous les professionnels engagés dans l’assistance aux personnes en fin de vie ne vous diront pas que cette réalité n’existe pas mais réduire la fin de vie à ce tableau relève de l’imposture.
La dignité, est-elle perdue parce que la personne qui atteint son terme l’accepte simplement ?
La dignité, est-elle valorisée parce que la personne choisit elle-même le terme de sa vie en se donnant la mort ou en laissant un tiers prendre cette responsabilité ?
L’argument de la perte supposée de la dignité humaine qui serait indissolublement liée à la condition de malade en fin de vie tombe de lui-même.
Devrons-nous renoncer pour autant à vouloir, envers et contre tout, accompagner celui qui s’en va avec des gestes simples, des mots simples, … tout simplement une présence, sous prétexte qu’une loi autorise l’aide active à mourir ?
On peut lire dans la version provisoire du projet de loi sur le fin de vie que « le médecin sera chargé de réaliser une évaluation médicale des demandes de « mort choisie ».
Là est tout le bouleversement qui traduit une volonté de révolution anthropologique : « la mort choisie ». Cette conception de « mort choisie » résume à elle-seule la motivation de ceux qui militent pour l’inscription dans la législation de l’aide active à mourir et de l’euthanasie.
Une législation ne changera pas les circonstances ni le fait que celui qui s’en va, s’en va sans qu’on puisse lui promettre autre chose qu’un apaisement qu’un geste létal ne sera jamais capable d’apporter.
Argumenter autour du motif de la douleur réfractaire que personne ne nie, et en particulier ceux qui travaillent au quotidien pour accompagner les patients en fin de vie, est un leurre qui n’a plus de raison d’être. Les témoignages de plus en plus nombreux de ceux qui en arrivent à demander le choix de mourir n’est plus la douleur, peut-être la souffrance parce qu’elle est une composante inéluctable de la fin de vie mais qui est prise en charge grâce au dévouement et à la compétence des personnes qui se consacrent à accompagner la fin de vie. C’est la solitude, voire l’abandon y compris de leurs proches parce que ni celui qui est en fin de vie ni ses proches ne sont accompagnés.
Et si le médecin n’affirmera pas qu’il n’existe pas de douleurs réfractaires, ou plus exactement difficiles à contrôler, on doit aujourd’hui affirmer que nous avons les moyens d’agir autrement que par un geste létal qui en supprimant celui qui souffre ne donnera toujours que l’illusion de supprimer la douleur.
Dont acte : nous combattons à armes inégales et nous sommes vaincus par plus fort que nous : la condition mortelle inéluctable.
Mais nous n’acceptons plus, aujourd’hui, cette contre-vérité de malades en fin de vie abandonnés dans d’atroces douleurs devant le silence coupable des médecins et de tout le personnel qui se dévoue dans les centres de soins palliatifs.
On lit aussi dans la version provisoire du projet de loi :
– que « Le suicide assisté ait obligatoirement lieu en présence d’un soignant ».
– que « L’aide à mourir, c’est-à-dire « l’administration d’une substance létale est « par principe » effectuée « par la personne elle-même. Mais qu’un médecin, un infirmier, ou un proche pourrait jouer ce rôle dans le cas où le malade n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
Posons-nous sérieusement les bonnes questions pour répondre, avec la conscience de nos limites, à l’interrogation qui nous provoquera un jour ou l’autre : je vais mourir mais comment ?
Le chef du service de réanimation d’un CHU avance qu’un patient peut se considérer en fin de vie très en amont de sa mort théorique et qu’alors l’écoute de celui-ci doit se centrer sur son éventuel « désir d’en finir ». Comment peut-on interposer indûment ce « diktat », car je ne vois pas d’autre mot pour qualifier cette attitude, quand un médecin a décidé lui-même que la personne est morte par anticipation.
Si la législation introduit « un droit à mourir » c’est à une telle attitude sans recours qu’on devra faire face et qui pourra s’y opposer ? De telles situations restent aujourd’hui, toutes proportions gardées, exceptionnelles, mais il est à craindre que même exceptionnelles elles ne deviennent « banales » si les responsables des services se voient couverts par la législation.
Si nous voulons défendre le principe inviolable du respect de la vie jusqu’à son terme naturel, il faut aussi exiger en contrepartie de la part des responsables, en l’occurrence les médecins qui prennent les décisions, le respect de toutes les conditions exigées dans la loi actuellement en vigueur (loi Claeys-Léonetti 2016) et garantes de la liberté du patient en fin de vie : les directives anticipées, la personne de confiance, l’assurance que toute décision sera prise en concertation … et évidemment que l’information médicale soit transmise de façon compréhensible et adaptée, sans attendre l’imminence de la mort, quand les conditions ne sont plus là pour une réflexion sereine.
Je reviens sur la conviction du chef de service de réanimation. Je ne suis pas convaincu que sa position soit la plus optimale pour se prononcer sur la fin de vie, parce que le patient en réanimation n’est pas le prototype du patient en fin de vie tel qu’une législation se propose de l’écrire. Il affirme que « légaliser l’euthanasie et le suicide assisté facilitera grandement son dialogue avec les proches ».
On a l’impression à lire les avocats de la cause de la mort choisie que la fin de vie se résume à quelques heure ou au plus à quelques jours. Cet intervalle de temps, bref, est capital et je n’en doute pas. Mais dans la vraie vie, il est le plus souvent le terme d’un temps long au cours duquel celui qui est malade prend de mieux en mieux conscience de la réalité de sa mort prochaine.
« Jusqu’à la mort accompagner la vie »[5]. Ainsi s’intitule une Fédération dont l’histoire est pionnière dans les soins palliatifs en France. La vraie question et a fortiori la vraie et seule réponse est celle-ci : accompagner celui va nous quitter sans entrer dans une programmation mathématique et l’accompagner jusqu’au bout, être là, être une présence pour tenir la main et non pas la main anonyme qui poussera le piston d’une seringue.
On me permettra un dernière citation :
« On est allé plus loin que cette pression discrète dans le Droit à la mort, (1895). A. Jost s’élevait contre le principe religieux de l’absolu de la vie qu’il juge à la fois inhumain pour le malade et nuisible aux intérêts de la société. En 1934, un pas de plus, c’est Alexis Carrel qui proposait la création d’établissements d’euthanasie pour se débarrasser de façon humaine et économique des gens nuisibles avec comme objectif l’édification d’une élite. [6]»
Et je n’ajoute qu’une date qui poursuit cette citation et on comprendra sans entrer dans le détail : le premier septembre 1939.
[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/06/22/fin-de-vie-comme-observe-dans-certains-pays-ayant-legalise-l-euthanasie-et-le-suicide-assiste-le-declassement-de-l-offre-palliative-serait-en-marche_6178765_3232.html
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253
[3] https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-dignite-de-la-personne-humaine
[4] Cf. L’Association pour le Droit à Mourir dans le Dignité (ADMD)
[5] https://www.jalmalv-federation.fr/jalmalv/mieux-connaitre-notre-mouvement/jalmalv-en-2016/
[6] https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2001-2-page-69.htm


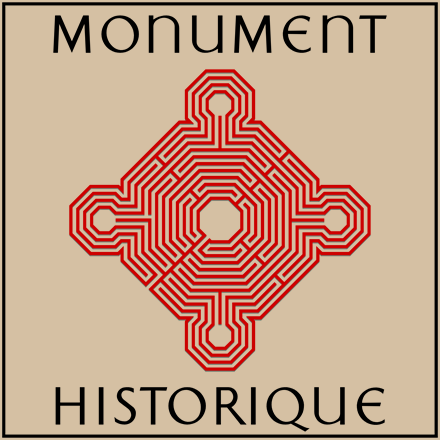



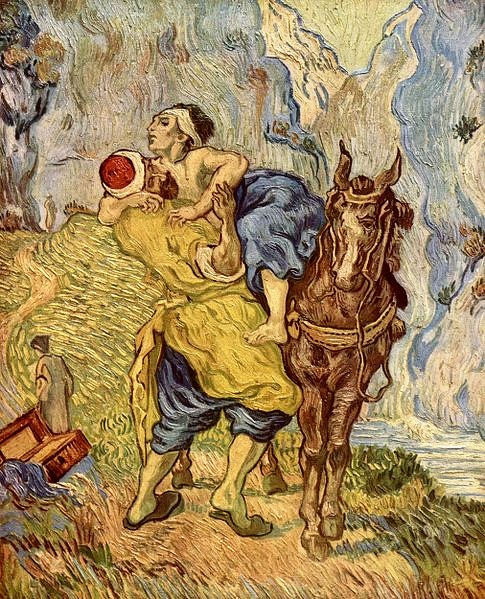
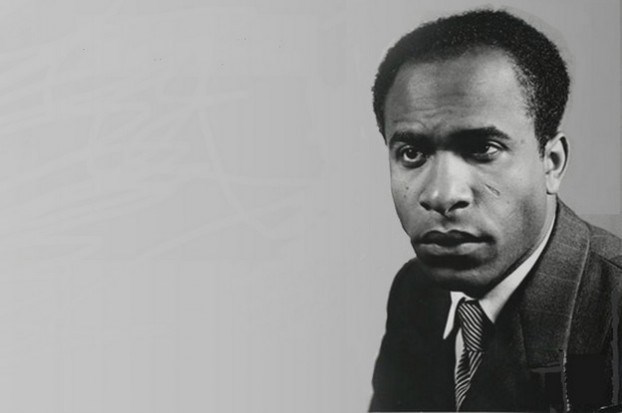
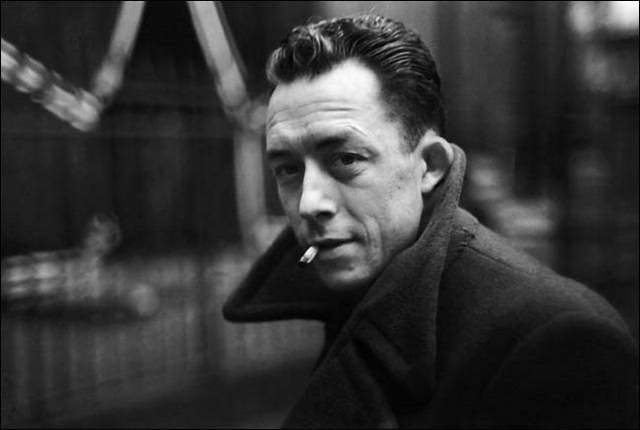
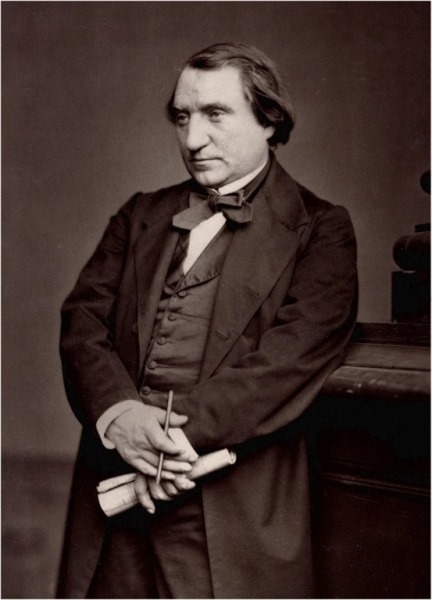
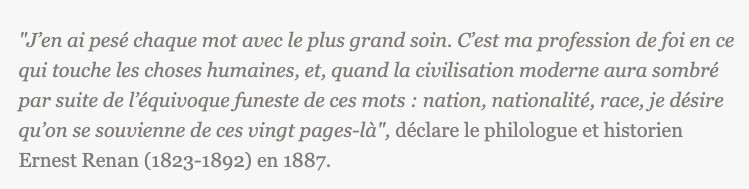
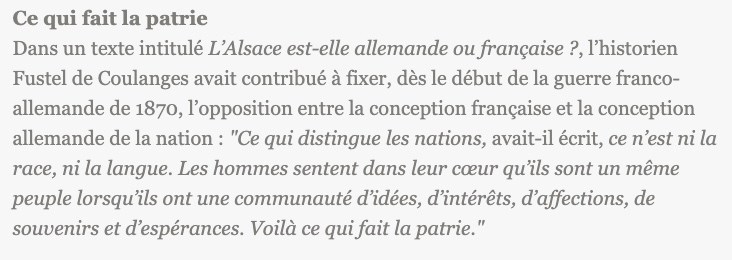
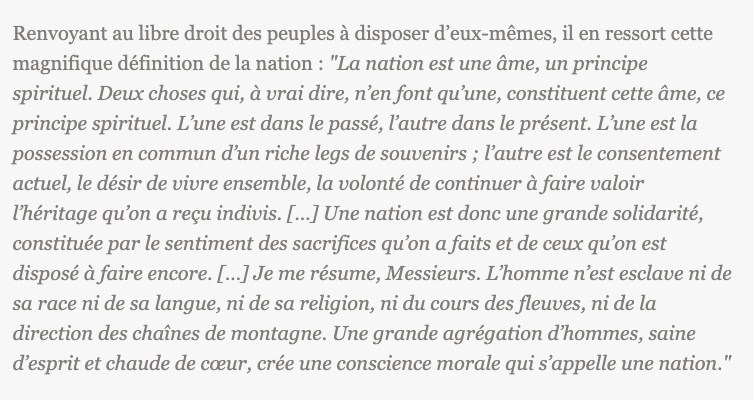

Commentaires récents